Jeudi 20 février, 13h30 – 16h30 MSH, Tours
Archives: Actualités
-
[Séminaire] Les terres cuites architecturales
Depuis quelques années, l’intérêt d’un nombre croissant de chercheurs s’est porté sur les questions liées aux terres cuites architecturales, depuis La Tène Finale jusqu’aux Temps modernes : techniques et typologie, chronologie, production et diffusion. Le temps semble venu de constituer, sous une forme ou sous une autre, un Groupe de Travail spécifique sur ces questions d’un point de vue diachronique. On milite, en particulier, pour une meilleure prise en compte de ces artefacts spécifiques dans les opérations de terrain, en fouille programmée ou préventive, voire prospections.
Programme (de 9h00 à 17h30) :
- Matinée : après un court exposé introductif d’Alain Ferdière, tour de table au cours duquel chacun présentera un aperçu de l’état des recherches régionales.
- Après‐midi : débat sur les perspectives et projets, en vue de l’organisation d’un groupe de travail, national ou plus large, sous une forme qui reste à définir.
Inscription obligatoire. Nombre de places limité.
Informations et programme complet sur l’affiche ci-dessous.
-
[Séminaire] Réseaux trophiques dans les hydrosystemes fluviaux
Ecologie des poissons de la Loire.
Jeudi 6 mars de 9h00 à 12h30 -
ANNULE — OMA Rem Koolhaas : une ethnographie de la subversion – Albena YANEVA
Conférence annulée.
Intervention de Albena YANEVA, professuer à l’université de manchester sur le thème “OMA Rem Koolhaas : une ethnographie de la subversion” le 21 janvier 2014 de 17h à 20h. Cette intervention sera suivie d’un débat animé par Jean Baptiste MINNAERT (Professeur d’histoire de l’art contemporain, Université de Tours).
Programme complet sur le site d’Intru.
Comme chaque séance, le séminaire est ouvert à tous sans inscription.
Consultez la programmation complète du séminaire 2013-2014. -
Séminaire méthodologique
PROGRAMME
- 9h00-9h15 : Accueil
- 9h15-10h30 : communication de Nathalie AUDAS suivie d’un débat Maître de conférences en Aménagement-urbanisme, Université Grenoble 2, UMR 5194 PACTE « De la comparaison des méthodes d’enquête à leur complémentarité »
- 10h45- 12h00 : Communication de Robert BECK suivie d’un débat Maître de conférences en Histoire, Université de Tours, CETHIS « Les écrits de for privé comme source historique : l’exemple du journal de F.C. Krieger, 1821-1872 »
- 14h00-15h15 : Communication de Jean-Yves PETITEAU suivie d’un débat Ingénieur de recherche en sociologie, UMR 1563 Ambiances architecturales et urbaines « Être, écouter, marcher : la méthode des itinéraires ; une expérience de la trace »
- 15h30-16h45 : Communication de Sophie CARATINI suivie d’un débat Directrice de Recherche CNRS, UMR 7324 CITERES « Les méthodes de l’anthropologie à l’épreuve du terrain saharien »
- 16h45-17h00 : Conclusion
Pour tout renseignement : denis.martouzet@univ-tours.fr
-
Séminaire MSH : Les corpus iconographiques
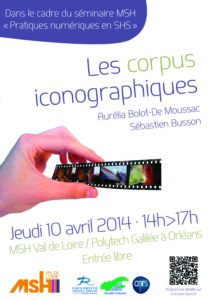 Organisé dans le cadre du séminaire de l’atelier numérique de la MSH “Pratiques numériques en SHS”
Organisé dans le cadre du séminaire de l’atelier numérique de la MSH “Pratiques numériques en SHS”Cette dernière session du 10 avril 2014 (de 14h00 à 17h00) sera consacrée aux corpus iconographiques.
Programme :
Romane : visite virtuelle d’une collection d’art roman par Aurélia Bolot-De Moussac (Centre Supérieures de Civilisation Médiévale (CESCM), UMR 7302, à Poitiers)
La base de données ROMANE, accessible via internet depuis janvier 2013, a pour objectif de permettre la consultation du fonds iconographique d’art roman du CESCM. La collection, constituée de plus de 160 000 clichés, offre une documentation qui couvre la France et une partie des pays européens tant dans les domaines de l’architecture, de la sculpture, de la peinture murale que dans ceux des manuscrits, de l’orfèvrerie, des vitraux. Un vaste programme d’indexation, de numérisation et de campagnes photographiques assure l’accroissement constant des données mises à disposition du public académique ou non.> Un exemple de traitement de corpus iconographique par Sébastien Busson (Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (CESR), UMR 7323, à Tours)
A noter que cette séance est organisée en collaboration avec l’Ecole Doctorale de Tours.
A Tours : rendez-vous à la MSH Val de Loire – 33 rue Ferdinand de Lesseps – Salle 147
A Orléans : session en visioconférence : rendez-vous salle Prony sur le site de Polytech GaliléeCompte-rendu
La base Romane du CESCM
La base Romane, développée par le CESCM, est une partie d’une grande photothèque rassemblée au cours de nombreuses années de recherche, qui réunit aujourd’hui sur différents supports 160 000 documents iconographiques ayant trait à l’architecture et aux arts visuels de la période romane. Sont consultables en accès libre environ 16 000 documents depuis janvier 2013. La grande richesse de cette base consacrée à l’architecture et l’art médiéval est, outre son aspect spécialisé, son indexation selon un thésaurus hiérarchisé. Ce thésaurus a été établi sur la base du Thesaurus Exemplorum Medii Aevi (THEMA) élaboré par le Groupe d’Anthropologie Historique de l’Occident Médiéval (GAHOM) , mais enrichi pour les données architecturales, ce qui a donné lieu au Thésaurus des images médiévales en ligne (TIMEL). Romane est une base documentaire, mais aussi de recherche, dans la mesure où nombre d’informations inédites y sont publiées au fur et à mesure de l’établissement des notices. La possibilité, à partir d’une recherche iconographique sur la base, d’exporter les images sous forme de diaporama ou de planche contact facilite également son utilisation pédagogique. Les outils de géolocalisation (via Google Maps) permettent par ailleurs de considérer les monuments dans leur contexte urbain (via Google Street View).
Pour des raisons de droit de diffusion des images, certaines notices ne sont pas en libre accès, et ne sont consultables que sur place, au CESCM à Poitiers. C’est notamment le cas des notices réalisées à partir de bâtiments ou d’objets faisant partie de collections particulières. De manière générale, la base Romane se refuse désormais à accepter les dons de photos sans droits d’usage ou les documents de mauvaise qualité : trop de problèmes ont été rencontrés par le passé au cours de programmes de numérisation pour qu’ils ne soient pas prévenus désormais en amont, et les acquisitions comme les nouvelles campagnes de photographie sont aujourd’hui rigoureusement encadrées, tant juridiquement que scientifiquement.
La structure informatique de la base a été créée sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des chercheurs du CESCM, tant en termes de fonctionnalités que de structuration de l’information scientifique (topographie, architecture, mobilier/objet, iconographie). Dans cette base, les images sont indexées au même titre que les objets (architecturaux, mobiliers…) auxquelles elles correspondent, ce qui permet de gérer les problèmes de droit ou simplement d’identité des documents iconographiques en même temps que les informations à proprement parler scientifiques auxquels ces documents sont attachés.
Les bibliothèques iconographiques du CESR
Les programmes de numérisation au CESR ont été mis en place, comme pour le CESCM, à partir de collections diverses rassemblées au sein d’un même laboratoire de recherche par des chercheurs venus de différents horizons. Tout programme de numérisation suppose un workflow bien défini en fonction des objectifs du programme, dont les étapes sont : 1/ la numérisation à proprement parler, 2/ l’archivage, 3/ le traitement, 4/ l’exploitation et la diffusion des documents, enfin l’indexation, qui peut prendre place à un moment ou un autre du workflow. Chaque étape pose ses problèmes de volumétrie, de protocole, de résolution, de délocalisation de sauvegarde, etc., chacune devant être contrôlée avant le passage à l’étape suivante.
Le CESR, après un tâtonnement dû à un marché et des solutions techniques encore en pleine gestation, a opté pour la création d’un certain nombre de bibliothèques numériques qui permettent de pérenniser les fonds iconographiques en les archivant. Ces différentes numérisations ont été rassemblées en différents portails thématiques (Architectura pour l’architecture, Bibliothèques virtuelles humanistes pour la littérature, Ricercar pour la musique) afin de rendre visibles et facilement interrogeables ces corpus.
La structuration du portail des BVH permet d’articuler les livres (avec informations bibliographiques), les pages (qui permet d’associer à tel livre un ensemble d’images) et le contenu de ces pages (textes ou images). Le programme des BVH a permis de développer, avec l’aide du Laboratoire d’Informatique (LI) de l’université de Tours, AGORA, un outil de reconnaissance des formes et analyse d’images (RFAI) dont le but initial a été de faciliter l’OCR des textes numérisés en débarrassant l’analyse informatique des pages des lettrines, bandeaux et autres éléments iconographiques. Paradoxalement, cela a permis d’identifier ces éléments dans les pages, et de les traiter dans des bases indépendantes, réunies dans la Base de typographie de la Renaissance (BATYR). Ces éléments sont indexés à l’aide du thésaurus international IconClass, dont les défauts – notamment son classement alphanumérique peu intuitif – sont en partie compensés par l’avantage du multilinguisme.
-
Séminaire MSH : Les archives ouvertes et HAL-SHS
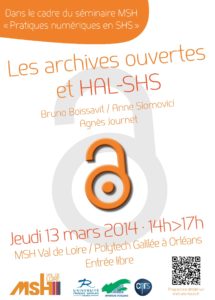 Organisé dans le cadre du séminaire de l’atelier numérique de la MSH “Pratiques numériques en SHS” Cette cinquième session du 13 mars 2014 (de 14h00 à 17h00) sera consacrée aux archives ouvertes.Programme : Archives ouvertes : les enjeux dans les politiques d’établissement et les projets internationaux par Bruno Boissavit et Anne Slomovici (SCD de l’Université de Tours)
Organisé dans le cadre du séminaire de l’atelier numérique de la MSH “Pratiques numériques en SHS” Cette cinquième session du 13 mars 2014 (de 14h00 à 17h00) sera consacrée aux archives ouvertes.Programme : Archives ouvertes : les enjeux dans les politiques d’établissement et les projets internationaux par Bruno Boissavit et Anne Slomovici (SCD de l’Université de Tours)- Archives ouvertes : l’importance de la politique d’établissement
- Sa déclinaison locale avec le portail HAL de l’université François-Rabelais : mise en place et premiers retours d’expérience
- Le GTAO (groupe de travail [national] sur les archives ouvertes) de Couperin : les missions, les objectifs
- Les projets au niveau européen : projet OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) et OpenAIREplus, projet FOSTER pour développer les compétences Open Access des communautés universitaires.
> Un exemple : le dépôt dans HAL-SHS par Agnès Journet (CESR, Tours) A noter que cette séance est organisée en collaboration avec l’Ecole Doctorale de Tours.
A Tours : rendez-vous à la MSH Val de Loire – 33 rue Ferdinand de Lesseps – Salle 147A Orléans : session en visioconférence : rendez-vous salle Prony sur le site de Polytech GaliléeCompte-rendu
Les archives ouvertes et l’open access
Les archives ouvertes s’inscrivent dans un mouvement général, l’open access, qui veut promouvoir la mise en ligne gratuite de documents et d’informations scientifiques, que ces contenus soient ou non soumis par ailleurs à des restrictions de droits d’utilisation mais dans le respect des contrats d’édition. L’expression « archives ouvertes » est directement traduite de l’anglais « open archive », ce qui explique qu’elle corresponde mal, en français, à la réalité qu’elle désigne. En effet, les archives ouvertes, telle que l’expression est utilisée aujourd’hui en France, désignent avant tout une sorte de bibliothèque numérique composée de deux éléments :
– les références bibliographiques de publications scientifiques ;
– les publications scientifiques elles-mêmes, quand les droits d’auteur le permettent.Cette archive se doit d’être ouverte et donc accessible en elle-même mais aussi moissonnable et consultable via des moteurs de recherche ou reprise dans d’autres archives.
Il existe plusieurs types d’archives ouvertes : disciplinaires (Arxiv pour la physique), institutionnelles (OATAO à l’université de Toulouse), ou nationales (HAL pour la France). Les archives ouvertes sont nées dans un environnement (les sciences dites « dures ») marqué par des pratiques éditoriales spécifiques à certaines disciplines : co-autorat, importance de l’article plutôt que du livre, etc. Les archives ouvertes se sont peu à peu étendues aux SHS, ce que marque l’ouverture de HAL-SHS en 2005.
La plateforme nationale de dépôt HAL se décline en domaines scientifiques (SHS, chimie, informatique, etc.), mais peut aussi être l’objet d’une déclinaison par établissements scientifiques – ainsi de la plateforme HAL mise en place par le service commun de documentation de l’université François-Rabelais, à Tours –, dans laquelle on peut trouver un classement par laboratoires, etc.
Le consortium Couperin, qui a pour mission de négocier l’achat de ressources documentaires pour les universités et établissements publics scientifiques et techniques, a souhaité accompagner les établissements et lever les freins qui pèseraient sur les archives ouvertes. Pour cela, il a recréé, en septembre 2013, un « Groupe de travail open access » (GTAO) dont les priorités sont de collaborer à l’amélioration de Hal, de fournir de la documentation à ses membres, de travailler sur les relations avec les éditeurs, de faire des enquêtes sur les pratiques…
L’objectif final de Couperin est d’arriver à l’obligation de dépôt dans les archives ouvertes qui ne pourra se décider qu’au niveau de BSN (Bibliothèque Scientifique Numérique) qui a pour objectif de mettre en cohérence l’ensemble des actions engagées sur le territoire et qui souhaite travailler avec tous les acteurs de l’édition sur les différents modèles économiques de l’Open Access : voies verte, dorée, hybride et platinum. Au niveau européen, la Commission Européenne et du Conseil Européen de la Recherche (ERC) militent pour une obligation de dépôt dans une archive ouverte des publications dès qu’il y a un financement public. Pour favoriser ce dépôt, le projet FOSTER qui vient de commencer vise à favoriser toutes les actions de formation. Enfin, le projet OpenAir+ permet de déposer les sources qui sont liées aux publications.Les avantages à déposer ses publications en Archives ouvertes
La publication de documents scientifiques dans des archives ouvertes revêt un certain nombre d’avantages pour le chercheur parmi lesquelles :
– l’augmentation de la visibilité des travaux ;
– la garantie qu’ils seront toujours disponibles grâce à un service d’archivage à long terme par le CINES ;
– la possibilité d’exporter des listes de publications sous forme de bibliographie imprimable ou sous forme de page web ;
– la possibilité d’avoir des statistiques de consultation de ses publications.Des bonnes pratiques
Déposer des publications scientifiques sur HAL nécessite l’intégration d’un certain nombre de bonnes pratiques, dont la plus importante est sans doute l’examen et le respect des droits d’auteur : l’auteur d’un article scientifique ne peut déposer son travail en archives ouvertes sans consulter la politique de l’éditeur qui l’a primitivement publié. Les sites Roméo pour les publications anglo-saxonnes et Heloise mis en place par le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD), permettent de consulter les possibilités de mise en ligne suivant le statut de la publication (article soumis, validé et version éditée) et les éventuelles durées d’embargos… Et de manière générale, rien n’empêche un auteur de déposer au moins les références de ses publications, qui favoriseront de fait leur prise de connaissance.
Ensuite, il importe de bien rassembler toutes les métadonnées d’une publication avant de commencer le dépôt sur la plateforme, la durée d’un temps de dépôt étant limitée, et aucune sauvegarde n’étant possible au cours de la procédure. Il importe également de se souvenir que la date de dépôt et l’identité du déposant permettent de marquer un acte juridiquement signifiant : ainsi la paternité d’une idée ou d’une découverte peut-elle être prouvée par la date de dépôt, et les publications collectives doivent-elles être faites avec l’accord des différents auteurs.
Après le dépôt, il est possible de modifier les métadonnées, d’exporter sous forme imprimable ou sous forme de page web une liste de publications, de consulter les statistiques de consultation des documents déposés, de créer des alertes email pour suivre les dépôts d’un déposant en particulier, etc. Un certain nombre de tutoriels ont été mis en place par le CCSD, disponibles en ligne.
Présentation – Les archives ouvertes
Présentation – Déposer dans HAL -
Initiation à l’encodage XML-TEI des textes patrimoniaux (imprimés et manuscrits)
Utilisée dans les milieux de la recherche en sciences humaines (linguistique, histoire, lettres, etc.), dans l’édition numérique et dans certaines bibliothèques, la TEI propose des solutions d’encodage XML pour les débutants comme pour les experts. Grâce à son système modulaire, elle s’adapte aux besoins spécifiques des projets pour éditer, diffuser, analyser, exploiter et visualiser les textes codés. Les recommandations du TEI Consortium proposent des solutions de codage spécifique pour les documents patrimoniaux, participant ainsi à leur valorisation.
Le CESR organise un stage les mardis 21 et 28 janvier et 4 février 2014. Il s’adresse en priorité aux étudiants du Master Professionnalisant du CESR et, en fonction des places disponibles, aux étudiants de l’université de Tours et autres institutions. Il se déroulera dans la salle Rapin du CESR et pourra accueillir 20 personnes maximum.
Vous trouverez ci-joint le programme de la formation qui sera assurée par :
- Lou Burnard (Consultant indépendant, membre du Conseil Scientifique de la TEI)
- Nicole Dufournaud (EHESS, Paris)
- Lauranne Bertrand (CESR, BVH)
- Jorge Fins (CESR, BVH)
Le CESR et l’équipe des Bibliothèques Virtuelles Humanistes (BVH) de Tours organisent depuis 2005 cette formation dont le public ne cesse de s’élargir de par l’expansion des possibilités liées au numérique. Initialement dispensée aux étudiants du Master professionnalisant Patrimoine Écrit et Édition Numérique du CESR, une session annuelle de formation continue à destination des professionnels, sera organisée sur 3 journées consécutives courant octobre 2014, en collaboration avec le Service de Formation Continue de l’Université François-Rabelais de Tours.
Stage ouvert et gratuit pour tout étudiant de l’université de Tours, sur inscription préalable avant le 15 janvier 2014 auprès de sandrine.breuil@univ-tours.fr.