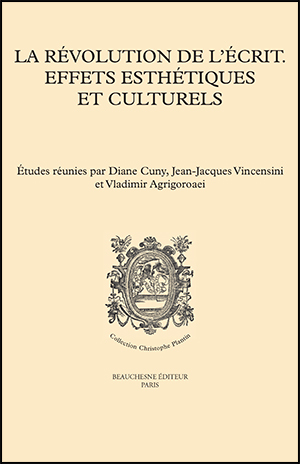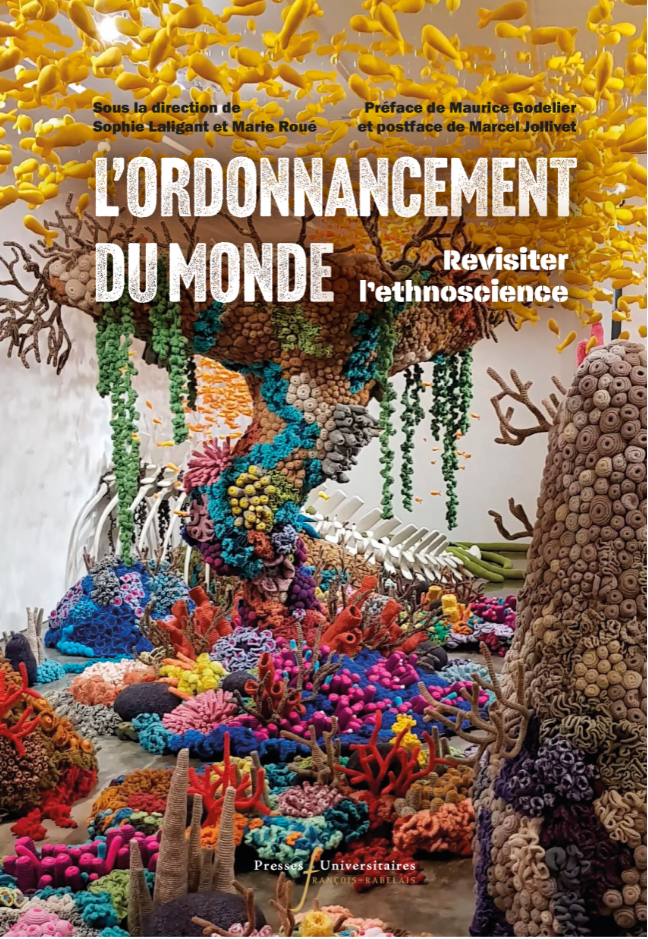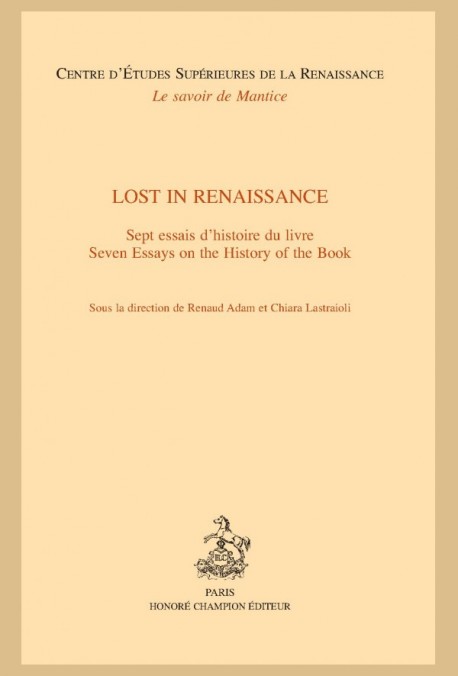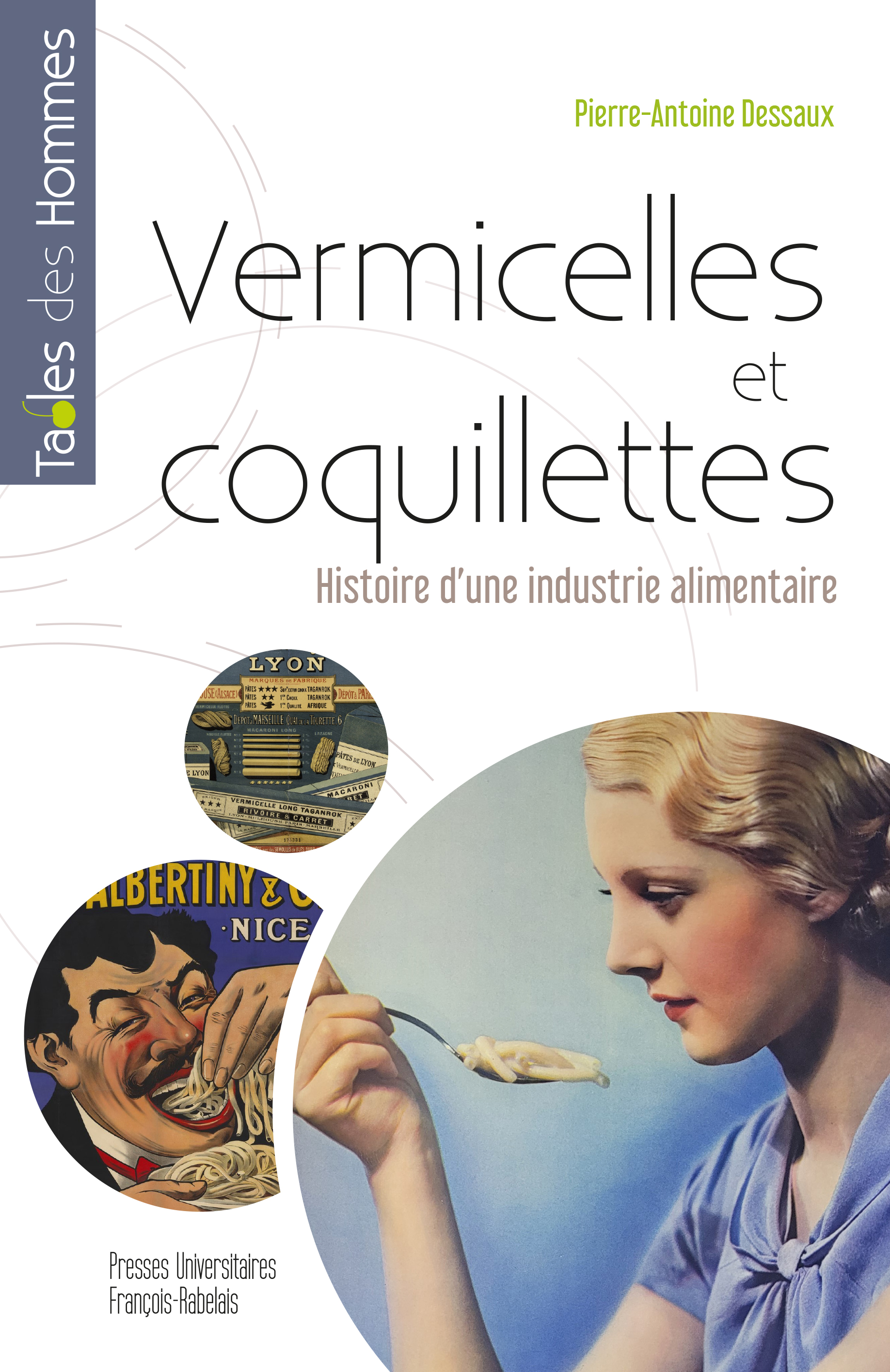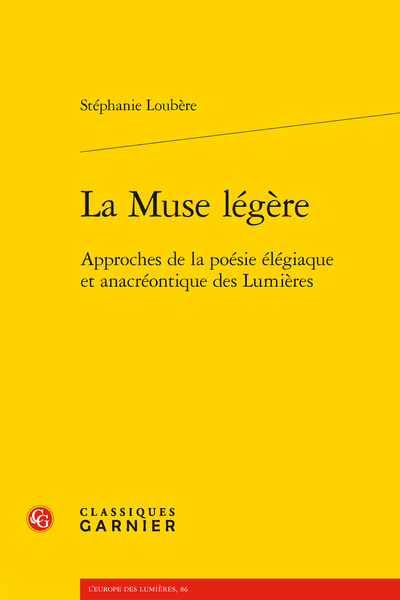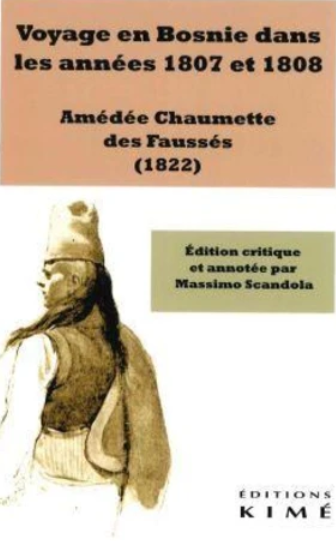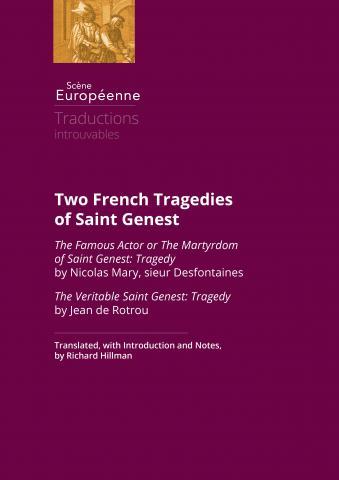- Auteur : Jean-Marc Largeaud
- Éditeur : Les Indes Savantes
- Laboratoire : CeTHiS
- Date de publication : juin 2023
L’histoire ne serait qu’une succession de sanguinaires folies guerrières. S’il est différentes manières de rendre compte du fait ou de le déplorer, depuis une trentaine d’années, les sciences sociales, les historiens, ont ramené la guerre au premier plan des préoccupations scientifiques, provoquant un renouvellement du questionnement sur l’activité guerrière, des réalités des combats à leurs représentations. Dans la même perspective, pour débusquer les rationalités de la guerre, ce volume reprend des expériences militaires, des « témoins », des récits de guerre, des batailles. Ils ont été enrôlés pour les besoins de la cause. L’entreprise fait partie du renouvellement de l’histoire des guerres. Un constat préliminaire s’impose : il n’existe pas de discours de la méthode spécifique aux thèmes militaires. Le seul recours, la fabrication empirique considérée comme intrinsèque au métier d’historien, peut le cas échéant ouvrir sur d’autres disciplines comme l’économie ou l’anthropologie. Dans ce volume, le point de départ est la notion de « récit de guerre », croisée avec des interrogations sur « l’événement » guerrier, sur « l’histoire-batailles », sur le « guerrier », sur le volontariat militaire, sur la nature du combat, sur la mémoire des guerres. L’axe de recherche suivi reste l’articulation des faits militaires et d’une histoire englobante qu’on définira, faute de mieux, comme « culturelle ». Une histoire où on s’attache à revisiter les lieux communs du récit de guerre, le questionnement du témoignage de guerre et, par voie de conséquence, la fabrication de l’histoire militaire.
Un des buts de ce livre est de reprendre la question du « récit de guerre » comme élément structurant du récit des historiens.