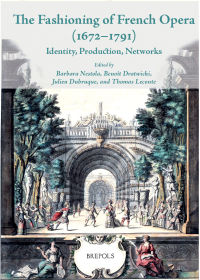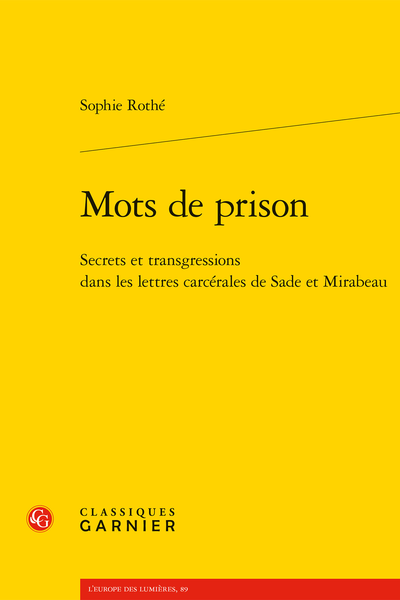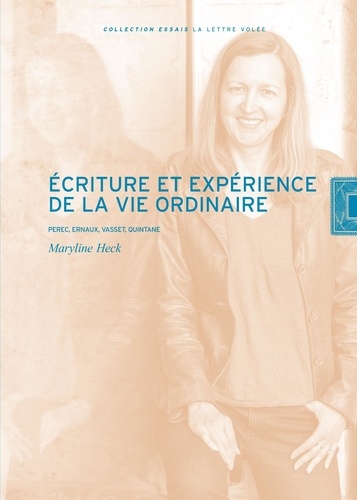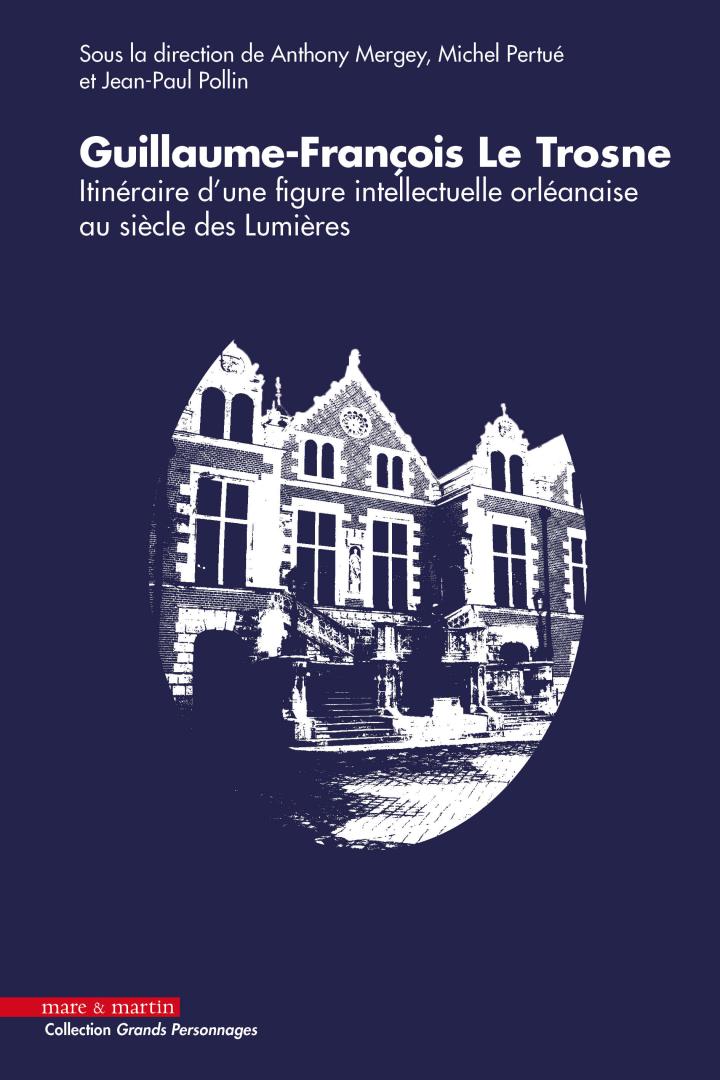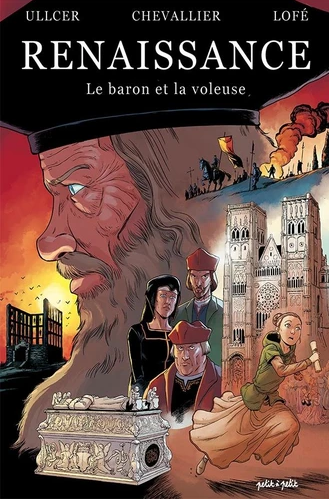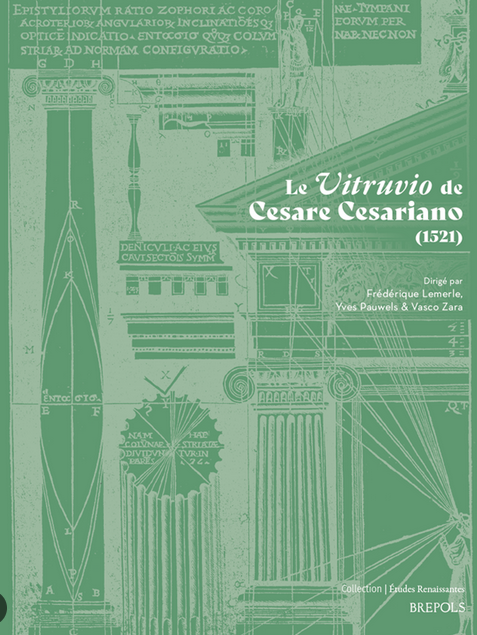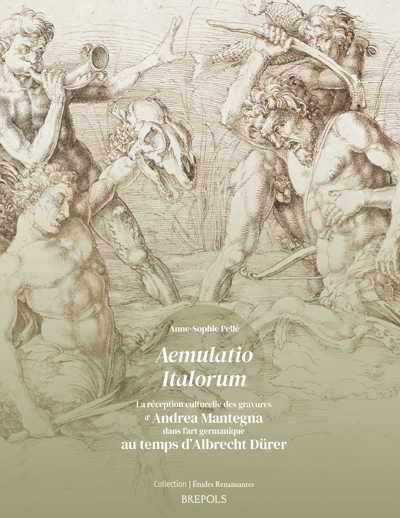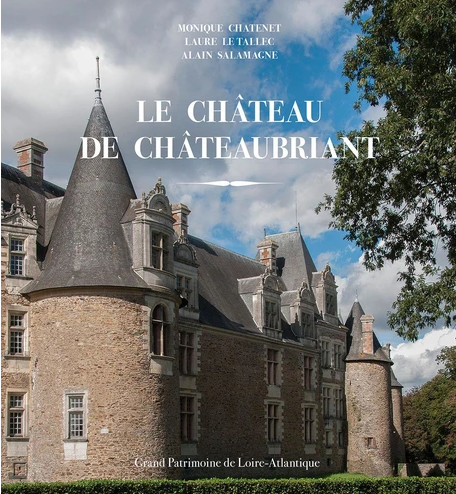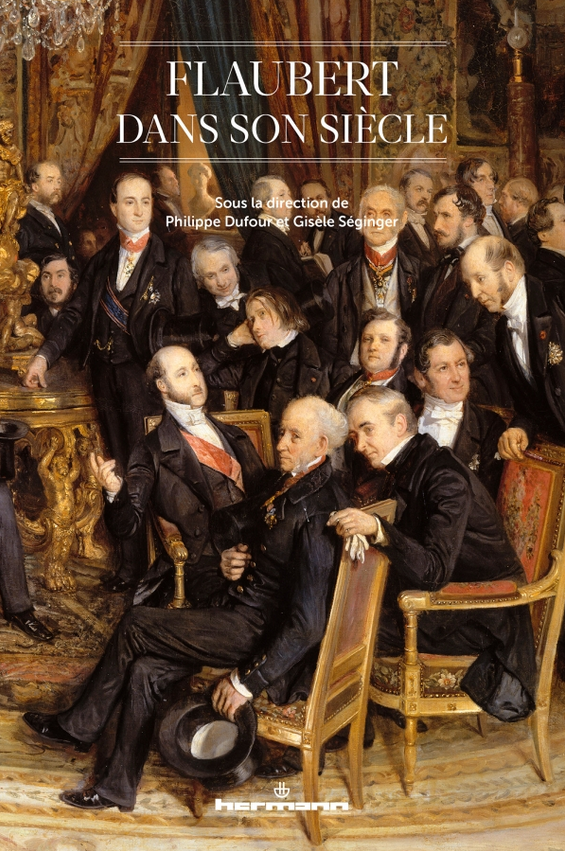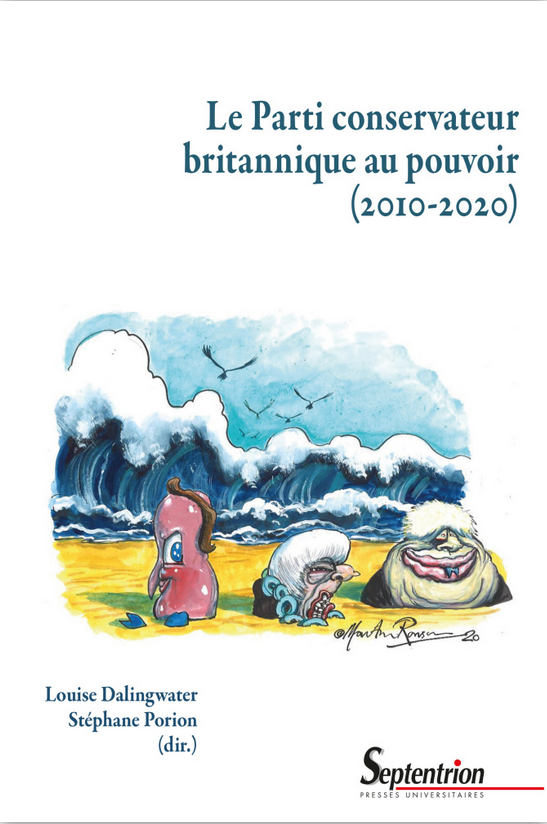- Auteur(e)s : Barbara Nestola, Benoît Dratwicki, Julien Dubruque, Thomas Leconte (eds)
- Éditeur : Brepols
- Laboratoire : CESR
- Date de publication : 2023
L’objectif de cet ouvrage, le premier en anglais consacré à l’Académie royale de musique aux XVIIe et XVIIIe siècles, est de reconsidérer cette institution sous un angle inédit grâce une approche pluridisciplinaire et trois fils conducteurs : questionner la nature même de l’institution, son inscription et son statut dans le réseau académique français ; éclairer des questions pratiques, logistiques et matérielles encore méconnues ; réévaluer ses interactions avec les autres scènes, non seulement de Paris, mais aussi de la cour et des provinces, et plus largement la diffusion de son répertoire. Pour une fois, ce ne sont pas ceux qui ont conçu les œuvres qui sont au cœur du discours, mais ceux qui leur ont permis d’exister et de leur donner vie : directeurs et administrateurs, interprètes, enseignants et artisans. Évoquées au fil des articles de cet ouvrage, leurs relations hiérarchiques, leur autorité et leurs responsabilités respectives permettent de mieux comprendre le processus de fabrique des opéras.