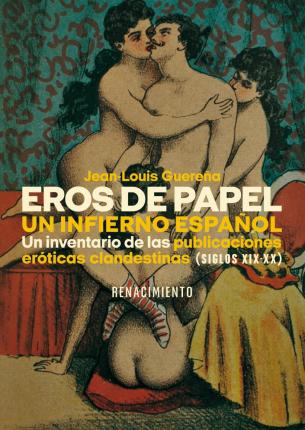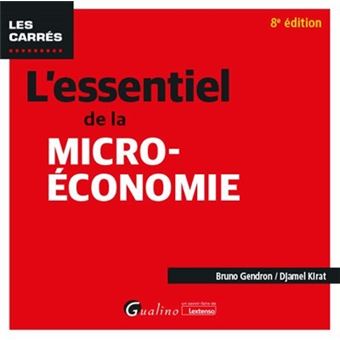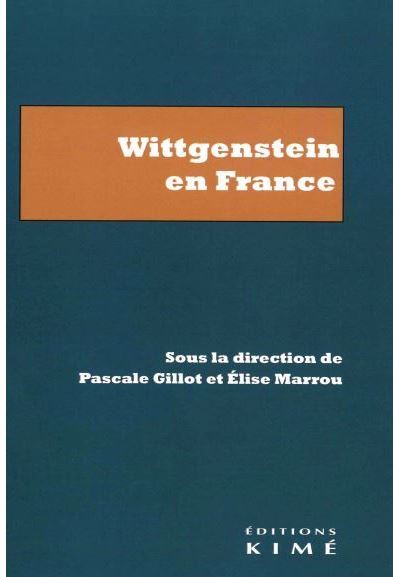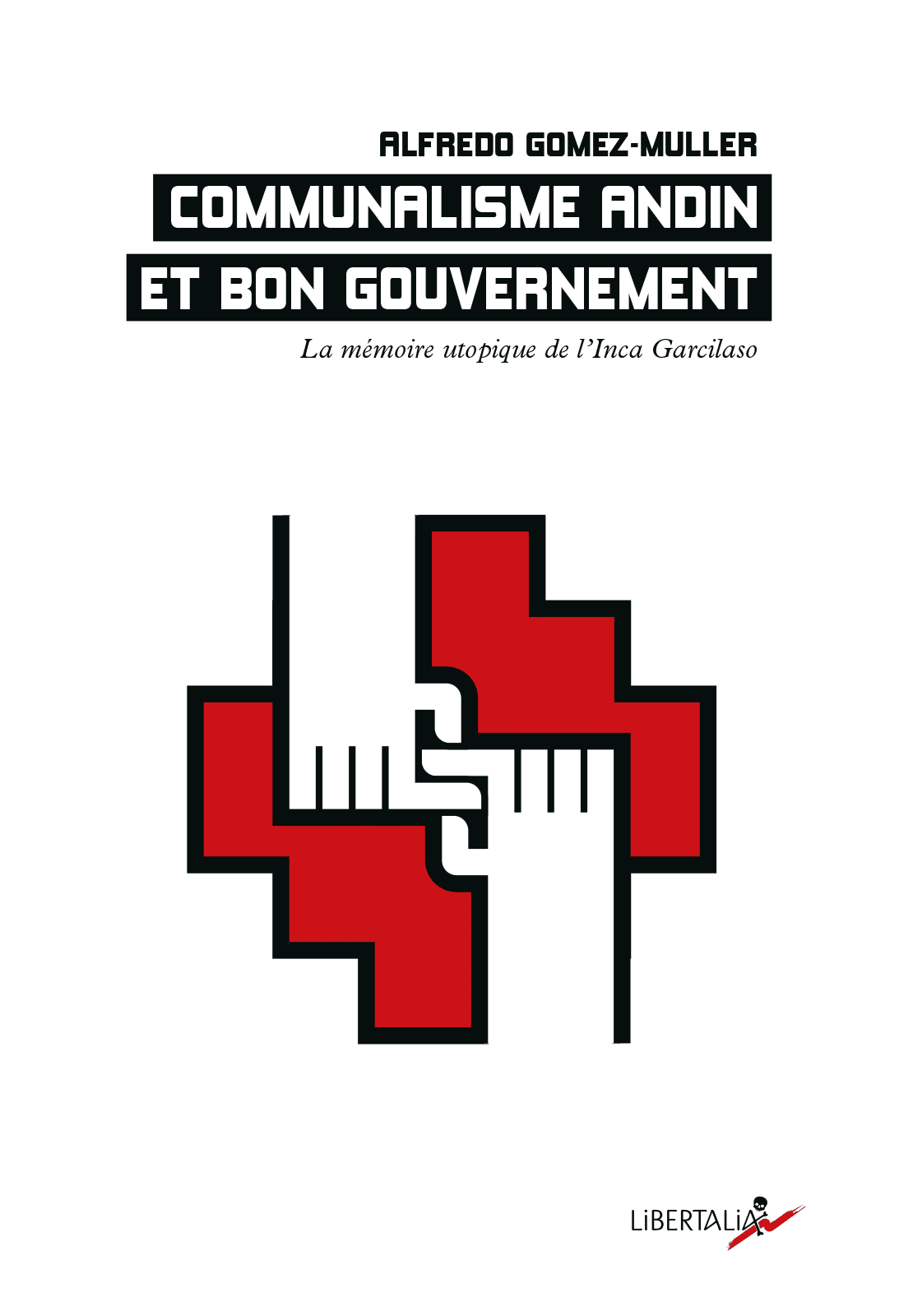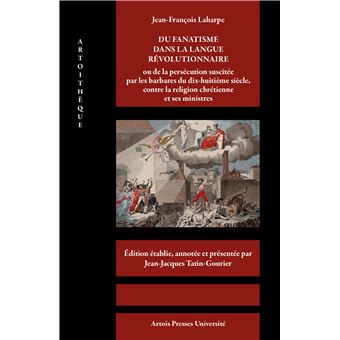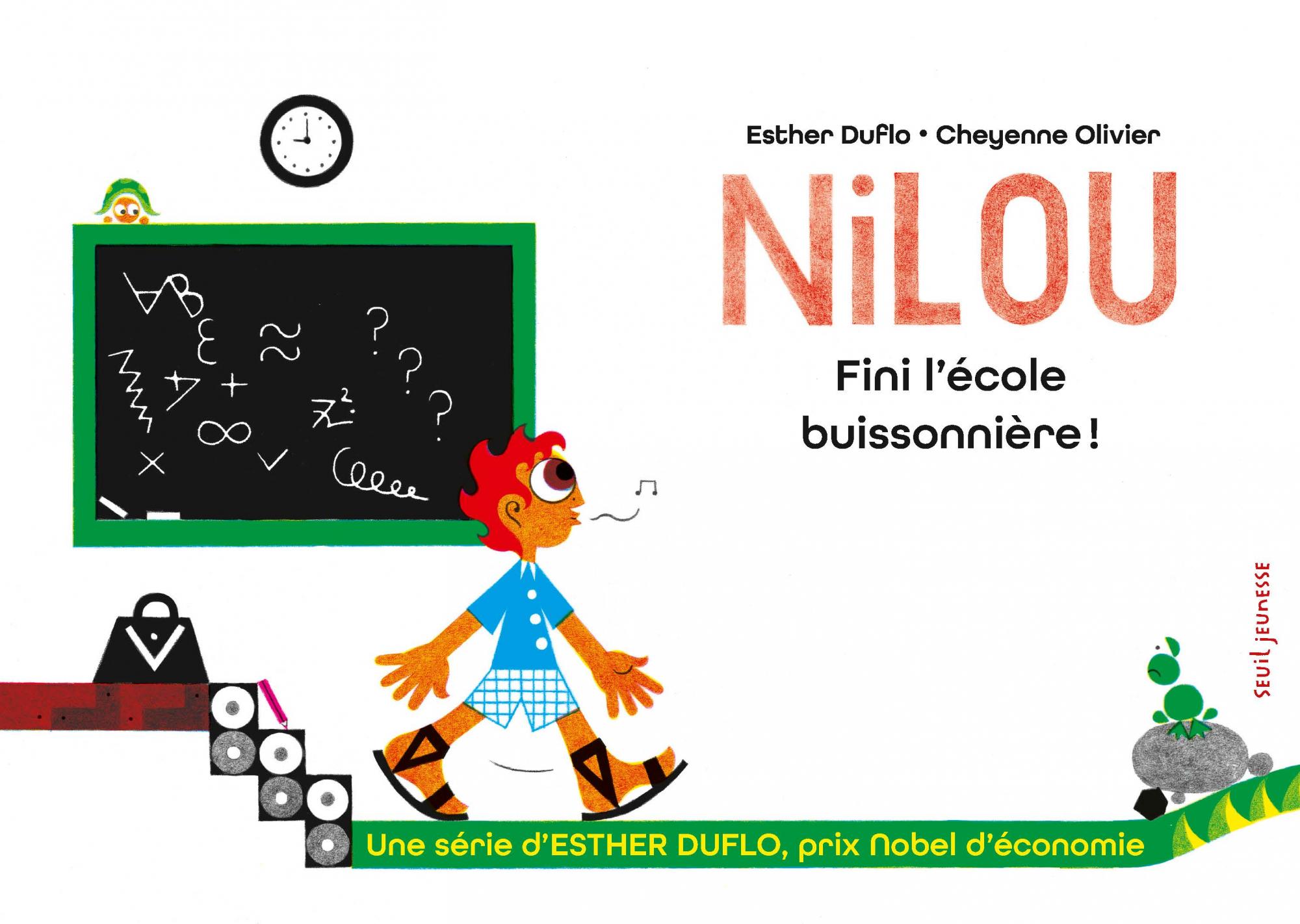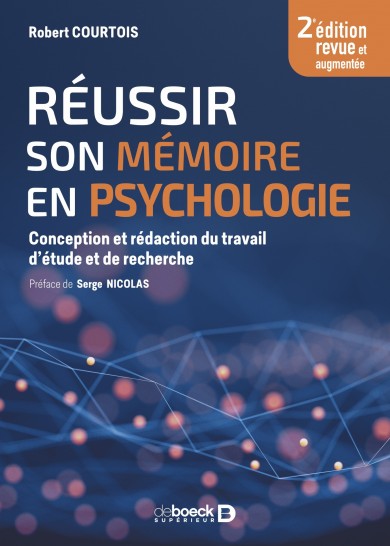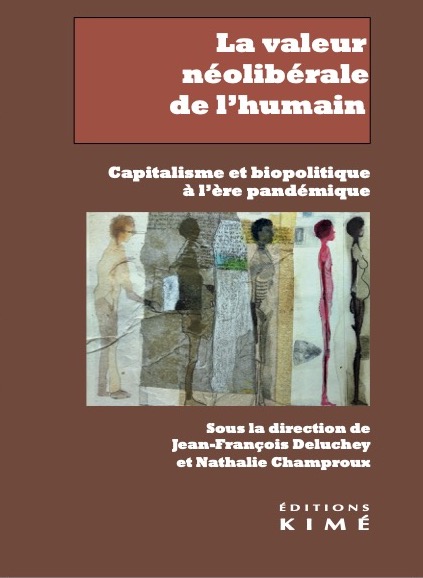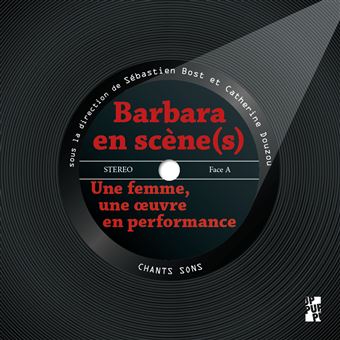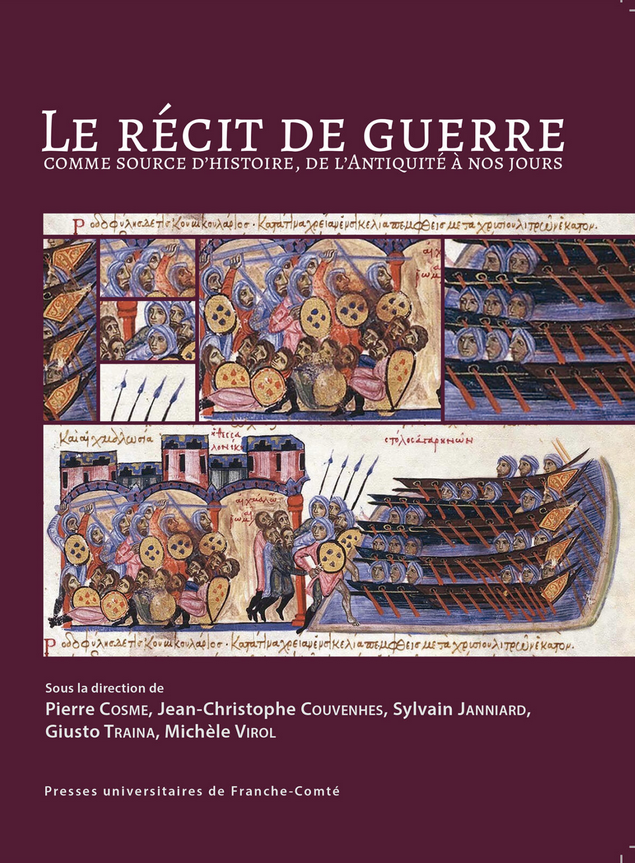- Auteur : Jean-Louis Guerena
- Éditeur : Editorial Renacimiento
- Laboratoire : ICD
- Date de publication : Octobre 2022
Sous le titre d’”Eros de Papier”, nous présentons la bibliographie la plus complète à ce jour des publications érotiques espagnoles, décrites et commentées, plus ou moins inconnues mais qui ont à voir avec la culture populaire. En 1877, Henry Spencer Ashbee, célèbre collectionneur anglais d’éditions de Don Quichotte mais aussi d’ouvrages érotiques dans toutes les langues, qualifie l’Espagne de “pays malheureux” dans le domaine de la production érotique imprimée. L’érotisme publié en espagnol et en catalan aux XIXe et XXe siècles, peu ou pas présent dans les grandes collections publiques européennes et très peu dans les collections privées, reste en effet la grande inconnue des études spécialisées et des bibliographies. Cependant, la production érotico-pornographique existait en Espagne depuis le début du XIXe siècle et était plus variée et étendue qu’on aurait pu le penser au début, en raison de la simple ignorance, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Dix ans après une première tentative publiée par “Libris” sous le titre d’ “Un enfer espagnol”, nous présentons donc une version considérablement renouvelée, corrigée et complétée de notre bibliographie érotique. Avec cet inventaire des publications érotiques clandestines espagnoles (près de 490 titres différents, mais beaucoup plus d’éditions, consultées directement dans la mesure du possible), nous entendons reconstituer ce qu’a pu être cet “Enfer espagnol”, ou du moins une partie de celui-ci, si l’ensemble de ces publications avait été conservé dans une bibliothèque publique, comme cela a été le cas en France ou en Angleterre.