[Colloque] La (mé)connaissance des droits des majeurs protégés

Sous la direction scientifique du Professeur Véronique Tellier-Cayrol (IRJI François-Rabelais) Informations et programme

Sous la direction scientifique du Professeur Véronique Tellier-Cayrol (IRJI François-Rabelais) Informations et programme
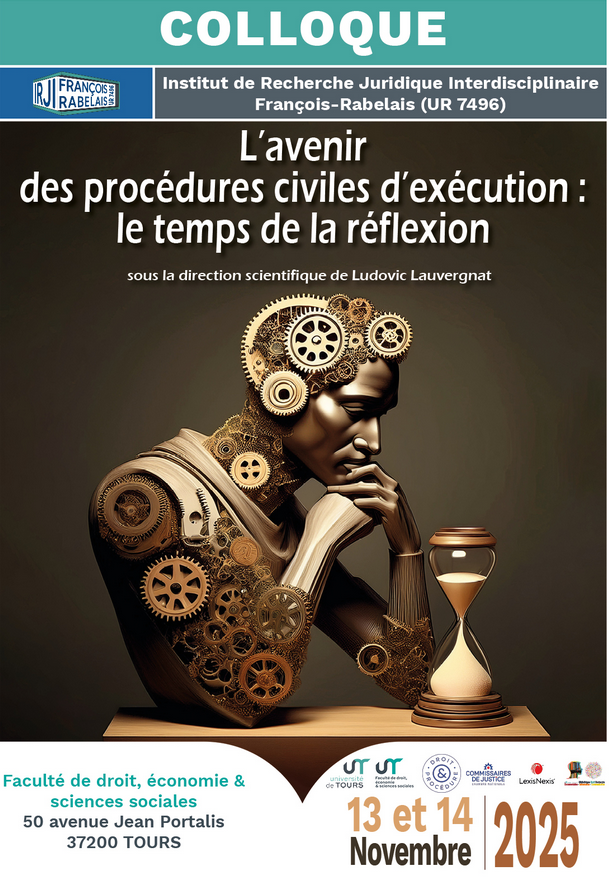
Sous la direction scientifique de Ludovic Lauvergnat Informations et programme
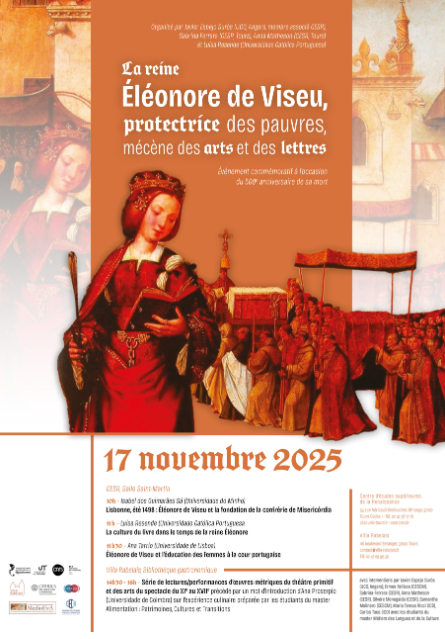
Événement commémoratif à l’occasion du 500e anniversaire de sa mort, organisé par Javier Espejo Surós (UCO, Angers, membre associé CESR), Sabrina Ferrara (CESR, Tours), Anna Matheson (CESR, Tours) et Luísa Resende (Universidade Católica Portuguesa) Informations

Journée d’étude organisée par Camille Esmein-Sarrazin (POLEN) et Claire Fourquet-Gracieux (Université Paris-Est Créteil, LIS) 2e volet du colloque international “Que sont nos autrices devenues ? Modèles et influences (XVIIe-XVIIIe siècles)” Informations et programme

Organisé par le Laboratoire d’Économie d’Orléans (LEO) Dans un contexte international marqué par les crises géopolitiques, les tensions commerciales et les transformations technologiques, la conférence « Les mutations de la finance dans un monde fragmenté » propose de réfléchir aux évolutions récentes de la finance mondiale. Quels sont les impacts de la fragmentation économique sur …
Continuer la lecture de « [Conférence] Les mutations de la finance dans un monde fragmenté »
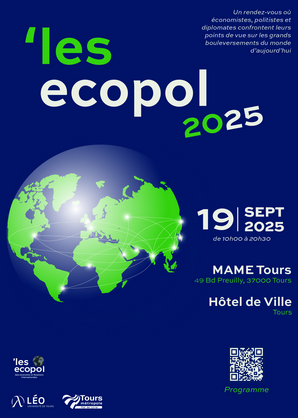
Organisé par le laboratoire le LEO (Laboratoire d’Économie d’Orléans). Les derniers chocs et autres évènements intervenus sur la scène mondiale –de la crise sanitaire à la réélection de D. Trump, en passant par le la guerre en Ukraine–marquent un changement profond des relations internationales qui sont de nature à bouleverser les équilibres économiques et géopolitiques. …
Continuer la lecture de « [Conférence] 1ère Conférence Annuelle « Les ECOPOL » »
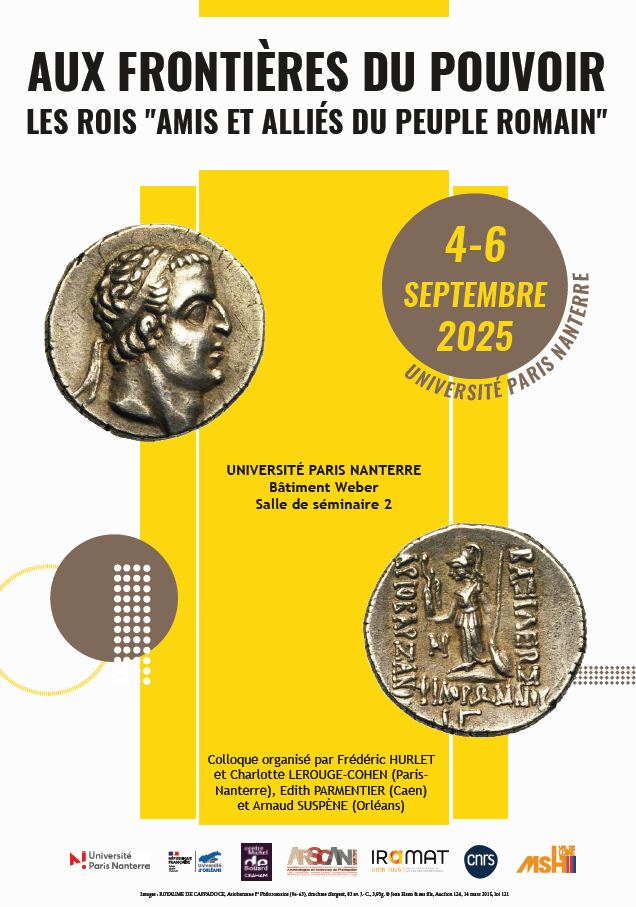
Colloque organisé par Frédéric HURLET, Charlotte LEROUGE-COHEN (Paris-Nanterre), Edith PARMENTIER (Caen) et Arnaud SUSPÈNE (Orléans) Télécharger le programme complet

L’axe Interactions humaines et sciences des données de la MSH Val de Loire organise une journée d’études transdisciplinaire sur la manière dont les sciences des données permettent d’améliorer les recherches sur les interactions sociales et humaines. Cette thématique est transversale et intéresse les recherches dans tous les domaines des sciences humaines et sociales. Comité d’organisation …
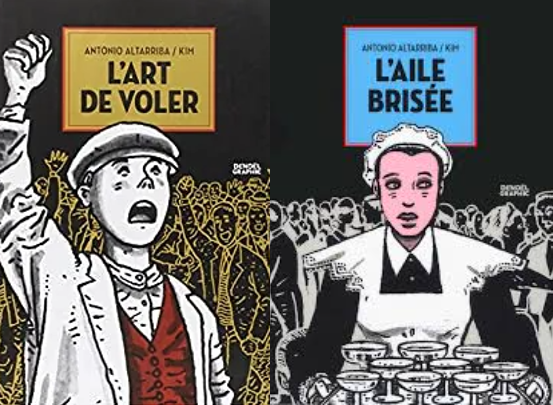
Séance du séminaire transversal CITERES-POLEN-InTRu “Quand la bande dessinée écrit l’Histoire : Comprendre les usages du passé par la BD”. Organisé par Matthieu Blin (Professeur agrégé d’histoire ; thèse en cours sur “La mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans la BD francophone de 1945 à 1970”, Université d’Orléans, POLEN-CEPOC), Jérôme Bocquet (PU en histoire …
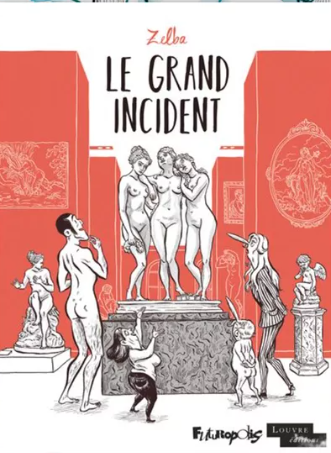
Séance du séminaire transversal CITERES-POLEN-InTRu “Quand la bande dessinée écrit l’Histoire : Comprendre les usages du passé par la BD”. Organisé par Matthieu Blin (Professeur agrégé d’histoire ; thèse en cours sur “La mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans la BD francophone de 1945 à 1970”, Université d’Orléans, POLEN-CEPOC), Jérôme Bocquet (PU en histoire …