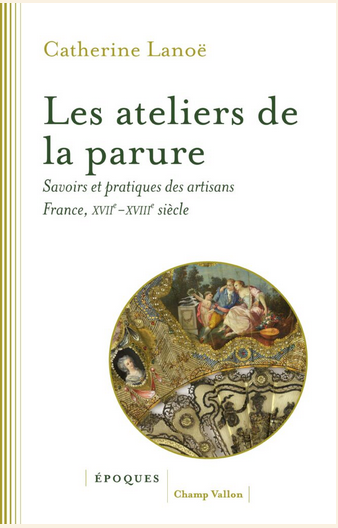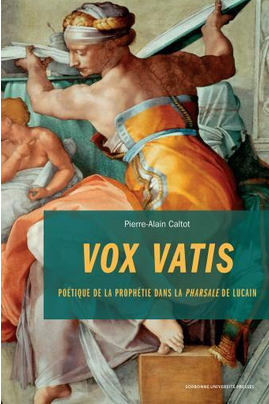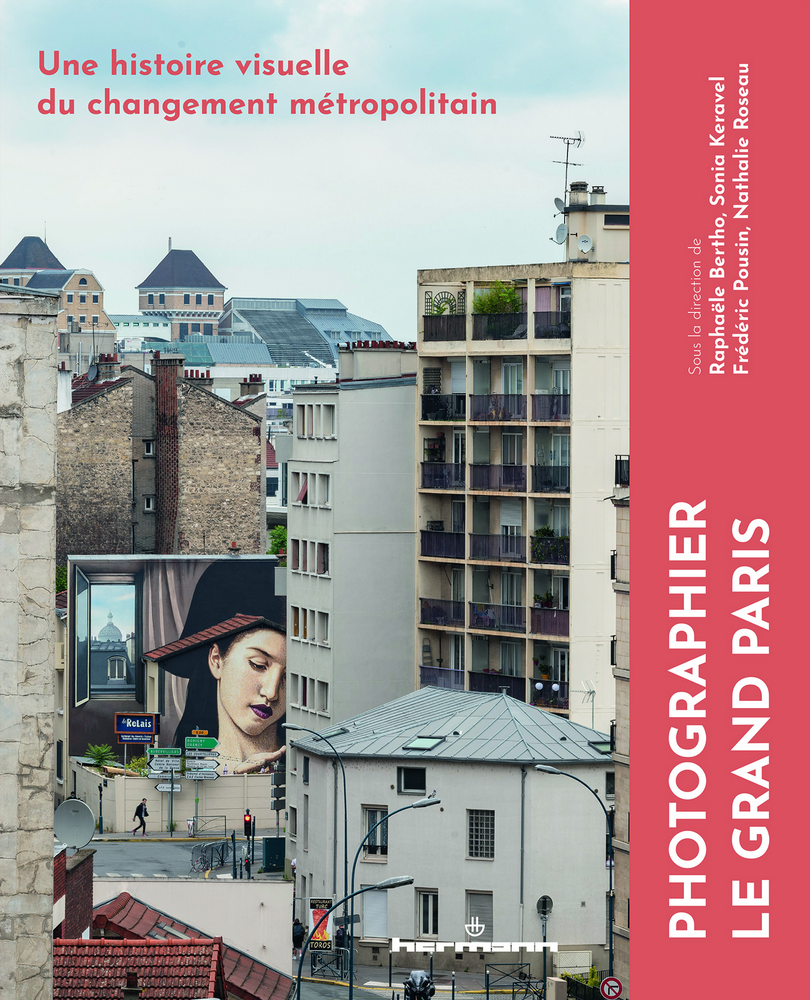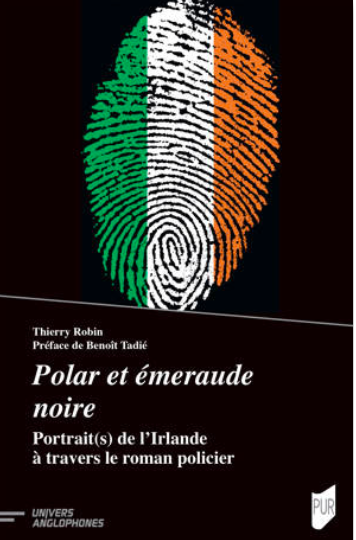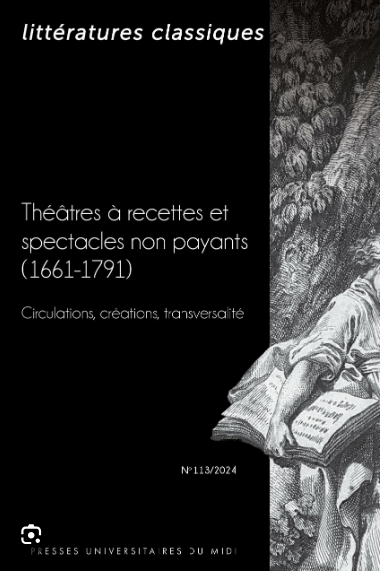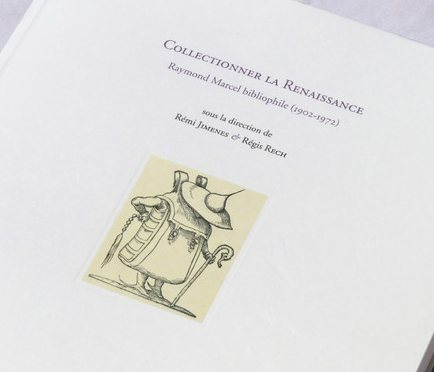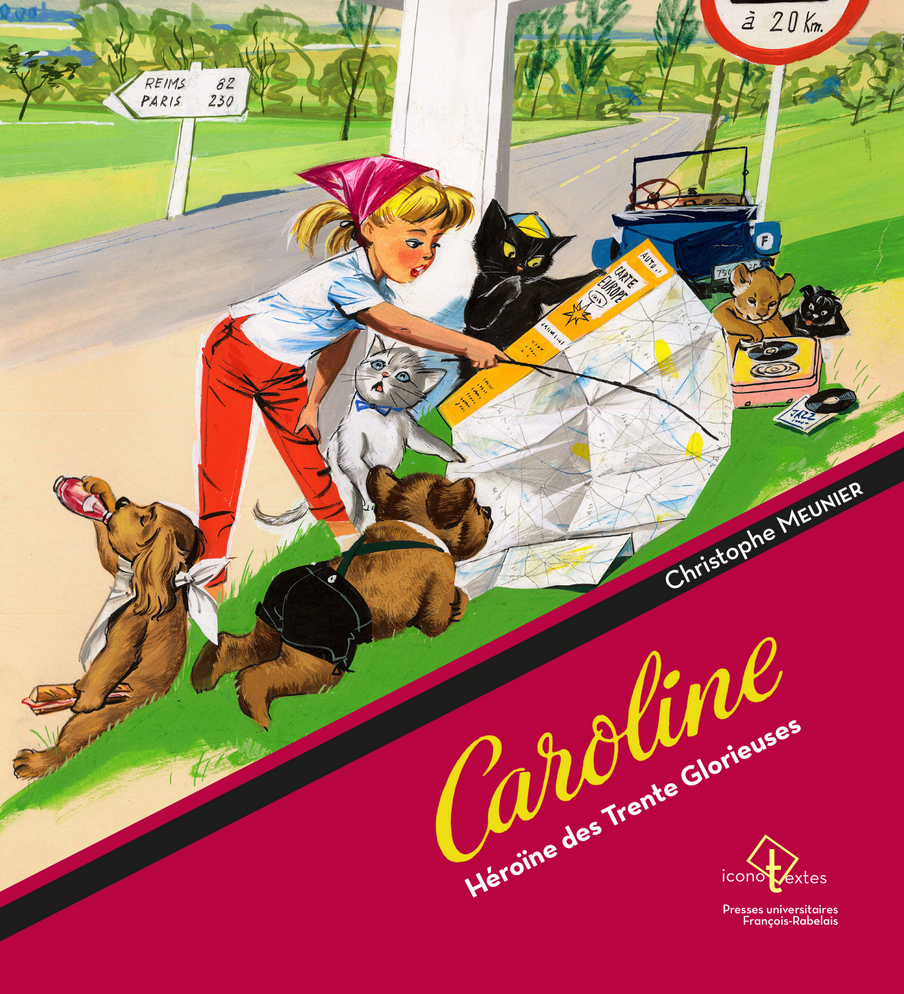- Autrice : Catherine Lanoë
- Éditeur : Champ Vallon
- Laboratoire : Polen
- Date de publication : septembre 2024
À partir de l’étude des gants, des éventails et des perruques, cet ouvrage articule l’histoire de la parure du corps et celle de l’artisanat, afin d’éclairer le socle technique de la « culture des apparences » des XVIIe et XVIIIe siècles. Grâce à l’exploitation d’un corpus d’archives manuscrites et d’objets de collection, la diversité matérielle des articles et celle de leurs appropriations sociales sont dévoilées, portées par l’inventivité des artisans. Loin d’être exclusivement des travailleurs manuels, ces derniers développent une pensée abstraite des produits et sont aussi des entrepreneurs. En amont de la révolution industrielle, ils promeuvent ainsi une organisation séquencée, segmentée et délocalisée de la production, qui repose largement sur le recours à une main d’œuvre féminine.
Catherine Lanoë est maître de conférences à l’université d’Orléans depuis 2005. Sa thèse, consacrée à l’histoire des cosmétiques à l’époque moderne, a été récompensée par le prix de la Société française d’histoire des sciences et des techniques en 2004 et publiée aux éditions Champ Vallon, en 2008, sous le titre La Poudre et le fard. Une histoire des cosmétiques de la Renaissance aux Lumières(rééd. 2022).