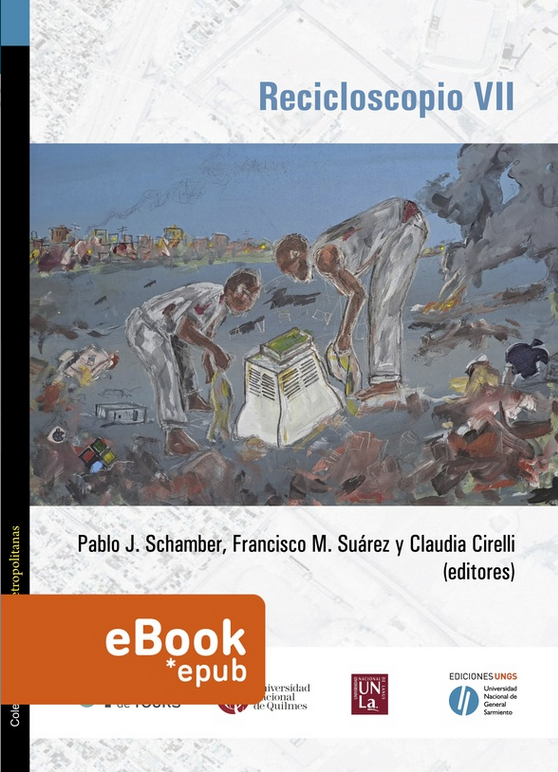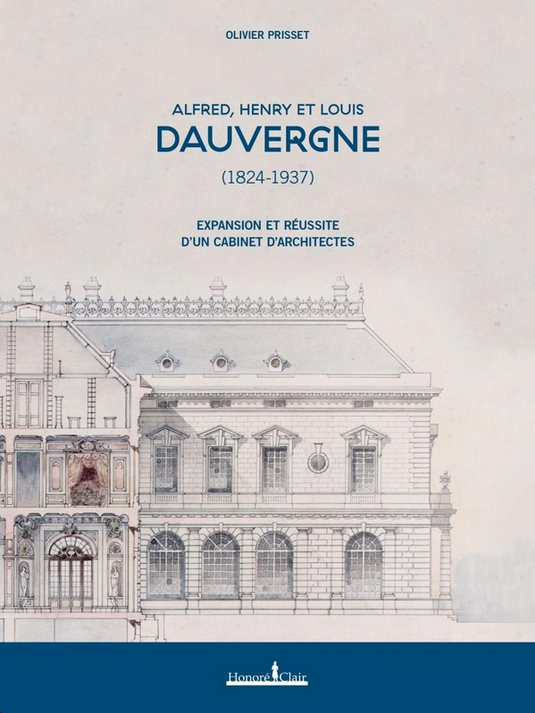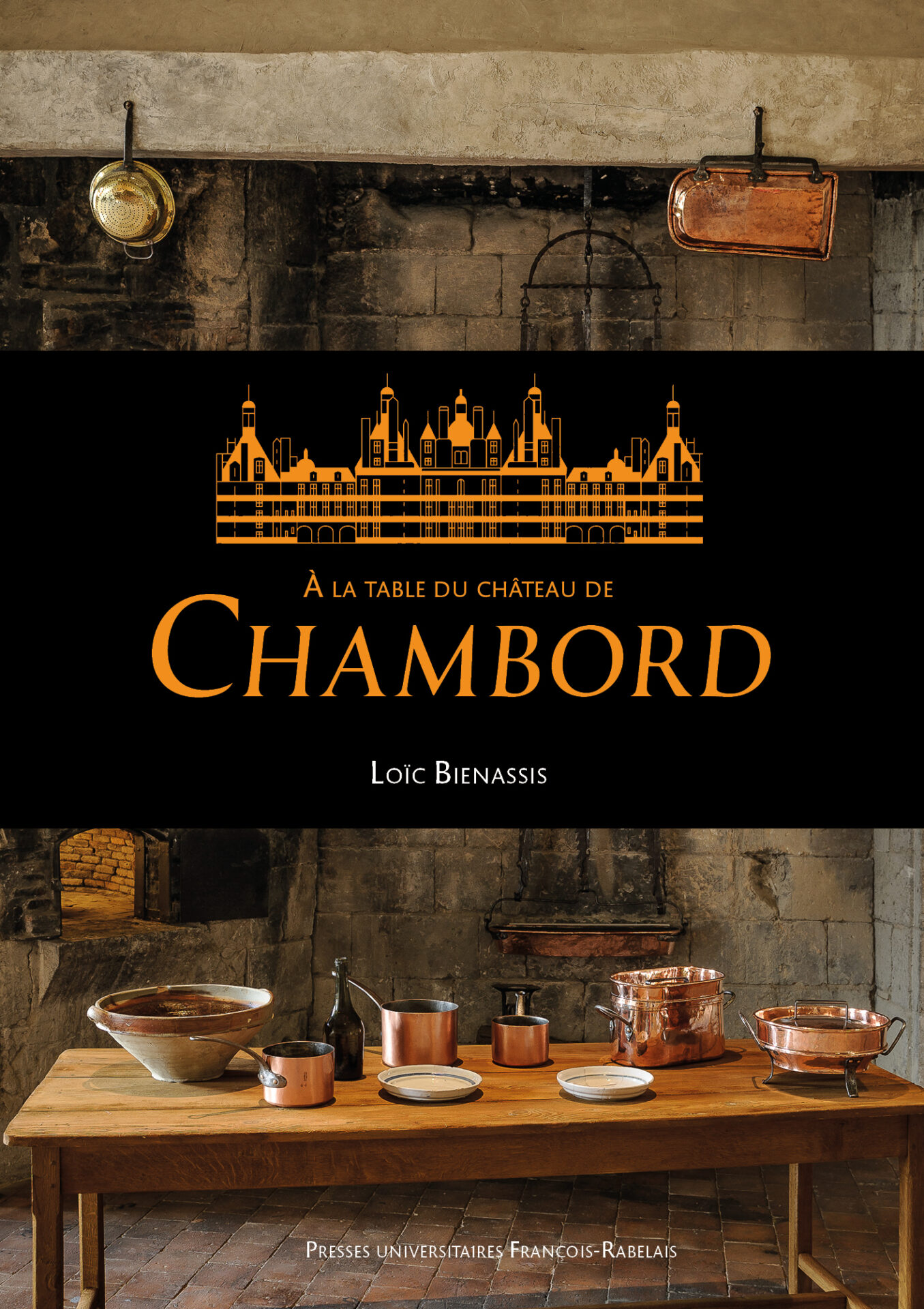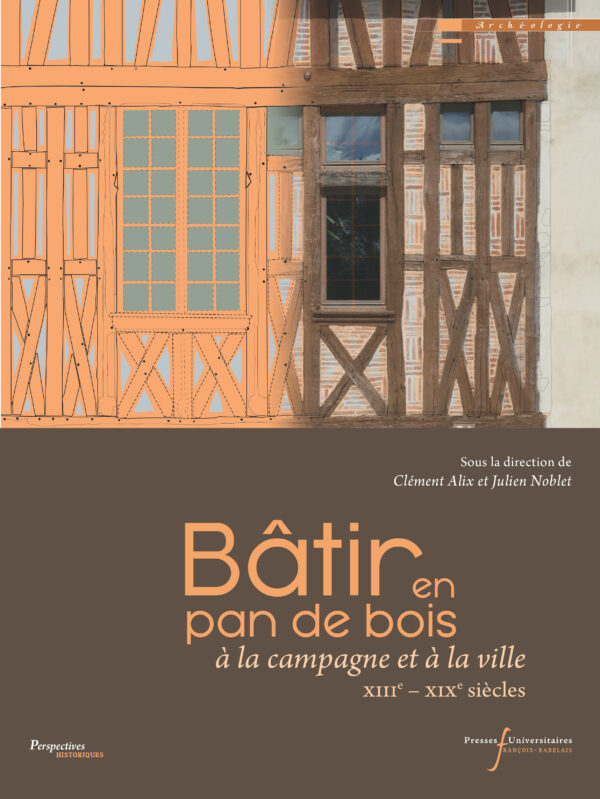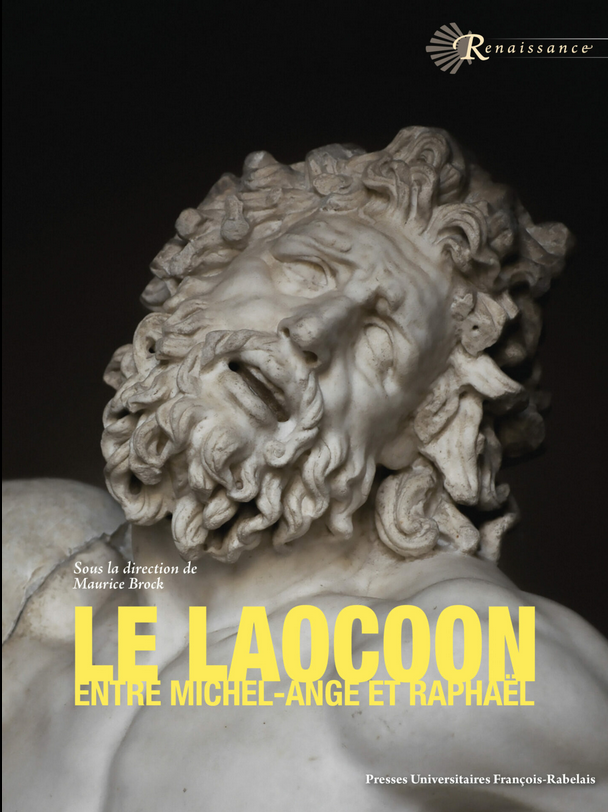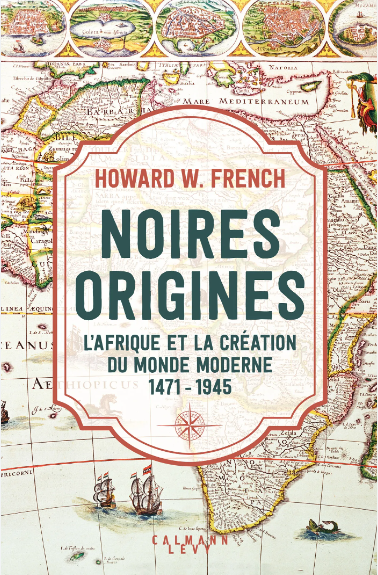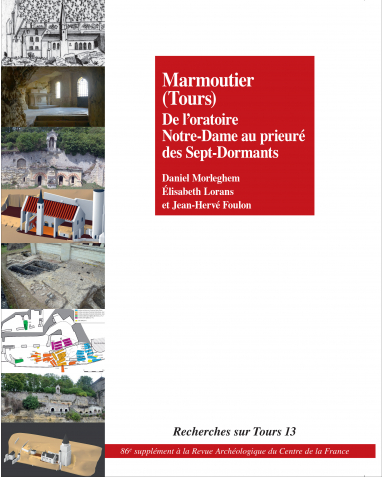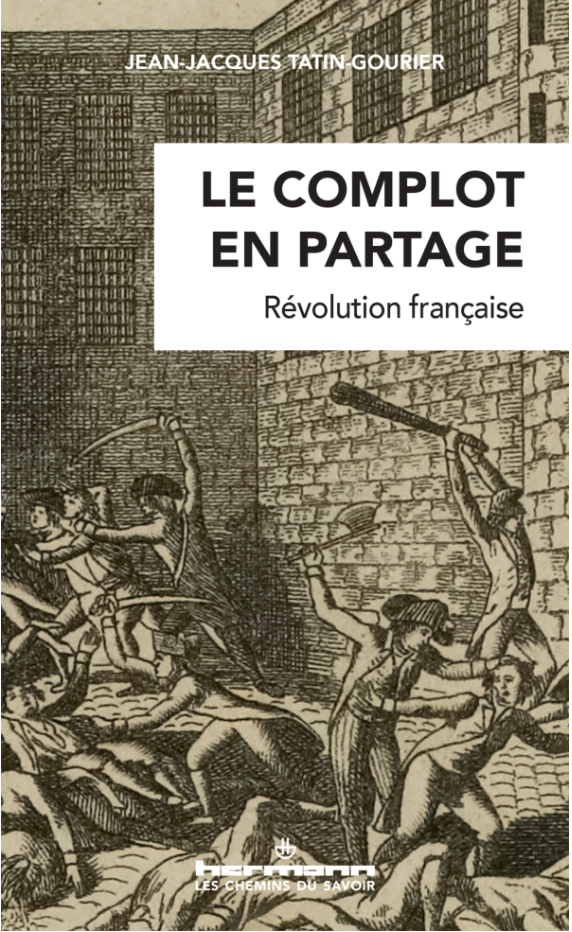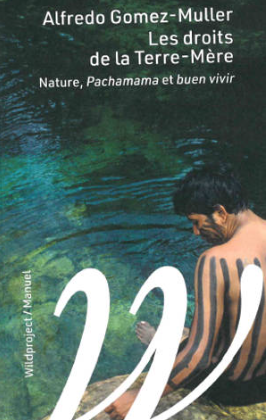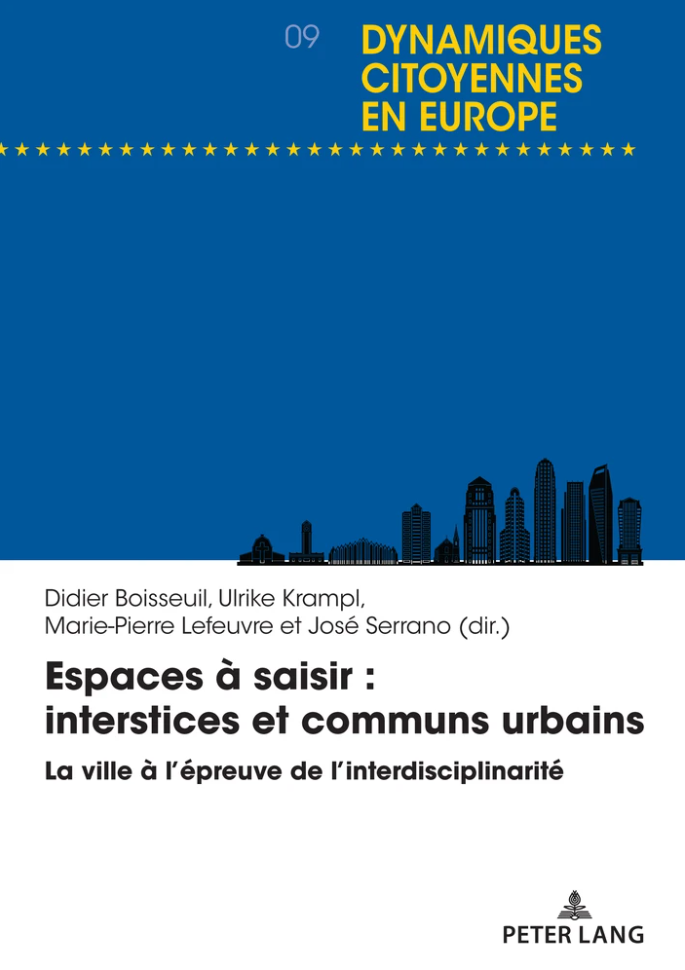- Auteurs et autrices : Adeline Pierrat, Carlos Henrique A. Oliveira, Chinedu Josephine Onyishi, Claudia Cirelli, etc
- Éditeur : Universidad Nacional de General Sarmiento
- Laboratoire : Citeres
- Date de publication : 2024
La collection Reciclosicoios est une archive vivante de la gestation et de l’évolution des études sociales sur les déchets et le recyclage en Argentine et en Amérique latine. Chaque édition propose une sélection de la production académique la plus et la récente et la remarquable et en pris en compte de nouveaux thèmes et débats, ainsi que des perspectives théorico-méthodologiques, ce qui fait en un nouveau domaine organisé. Cette septième édition ne fait pas exception, soulignant par exemple l’expansion du modèle croissant d’économie ; ou la productivité d’approches telles que l’écologie, l’intersectionnalité et l’analyse basée sur l’image. Mais Recicloscopio VII se distingue en outre par l’extension des limites du domaine à l’échelle transcontinentale aux sociétés situées en Afrique, en Asie et en Europe.